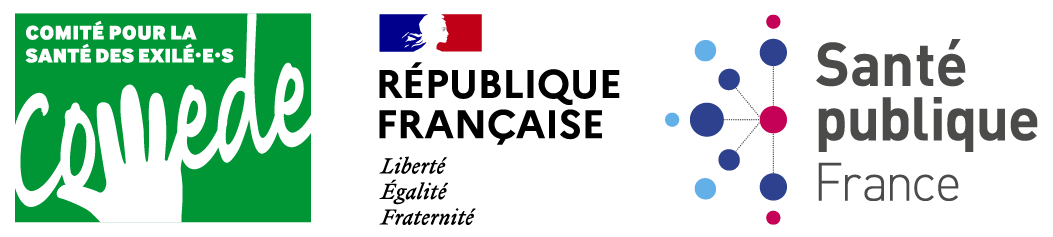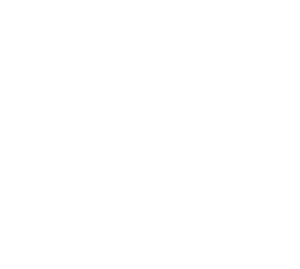16.3. Éducation thérapeutique du patient
Prévention et promotion de la santé
Article mis à jour le 18 novembre 2025
Née dans les années 1970 pour aider des patients diabétiques à gagner en autonomie en adaptant leurs traitements à leurs besoins, l’éducation thérapeutique du patient (ETP) a été reconnue comme incontournable par l’OMS en 1996 pour l’ensemble des personnes atteintes de maladie chronique. Dans un contexte de précarisation sociale et administrative des étranger.e.s, les personnes migrantes malades doivent pouvoir accéder à des programmes d’ETP, combinant des approches individuelles et collectives, dans des lieux de prévention et de soin qui soient accessibles et permettent le recours à un interprétariat professionnel chaque fois que nécessaire.
Définitions de l’ETP
En 1998, l’OMS donne une définition générale de l’ETP : « L’éducation thérapeutique vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Elle fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient. Elle comprend des activités organisées, y compris un soutien psychosocial, conçues pour rendre les patients conscients et informés de leur maladie, des soins, de l’organisation des procédures hospitalières, et des comportements liés à la santé et à la maladie. Ceci a pour but de les aider (ainsi que leurs familles) à comprendre leur maladie et leur traitement, collaborer ensemble et assumer leurs responsabilités dans leur propre prise en charge, afin de les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie ». Dans ses publications ultérieures sur l’ETP, l’OMS insiste sur le support à l’autogestion (self-management) d’états de santé et sur la littératie en santé (voir infra). Selon le guide du bureau Europe, l’ETP est présentée comme « ‘une intervention éducative visant à améliorer les résultats cliniques et la qualité de vie, menée par des professionnels de santé pour aider les patients à gérer eux-mêmes leur maladie chronique avec le soutien de leurs soignants et de leurs familles ».
En 2007 en France, la Haute Autorité de Santé (HAS) et l’INPES (devenu depuis Santé Publique France) réalisent un guide méthodologique sur la « construction d’un programme d’ETP » qui propose une définition, des objectifs et des modes d’organisation pour mieux structurer l’ETP. Selon la HAS et l’INPES : « Les finalités de l’éducation thérapeutique du patient sont :
- l’amélioration de la santé du patient (biologique, clinique) et l’amélioration de sa qualité de vie et de celles de ses proches ;
- l’acquisition et le maintien des compétences d’auto soins et la mobilisation ou l’acquisition de compétences d’adaptation (compétences psychosociales). »
Depuis la loi du 21 juillet 2009, l’éducation thérapeutique du patient est désormais inscrite dans le Code de la santé publique (art L1161-1 à L1161-4). La loi donne ainsi la possibilité de promouvoir et de développer, de façon pérenne et au plus près des lieux de vie de la population concernée, des programmes d’éducation thérapeutique du patient. L’éducation thérapeutique s’inscrit dans le parcours de soins du patient. Elle a pour objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie.
Déroulement de l’ETP, avec l’accord du/de la patient.e
Les intervenant.e.s en ETP doivent avoir reçu une formation spécifique d’une durée de 40h, voir le site Education thérapeutique du patient – Ministère de la santé et de l’accès aux soins (sante.gouv.fr)
Selon l’Art. L1161-2 CSP, les programmes d’ETP sont conformes à un cahier des charges national fixé par arrêté du ministère de la santé et fondé sur les recommandations de la HAS. Ils sont déployés au niveau local après déclaration auprès des ARS, et donnent lieu à des programmes personnalisés, conduits dans le respect de la Charte d’engagement destinée aux divers.e.s intervenant.e.s impliqué.e.s dans des programmes d’ETP, professionnel.le.s de santé ou non ou patient.e.s intervenant.e.s.
Diagnostic éducatif, ou BEP (Bilan éducatif partagé). C’est un temps d’écoute pour laisser la personne s’exprimer. Comprendre ce qu’elle connaît de sa maladie et comment elle vit avec son affection et son traitement. Evaluer sa vie sociale et son environnement. Identifier ses besoins et ses attentes. Identifier les situations de vulnérabilité psychologique et sociale. Evaluer ses connaissances et prendre en compte ses projets. Souvent c’est le moment et le lieu où la personne exprime pour la première fois ses craintes et ses peurs liées à sa pathologie.
Négociation d’objectifs. Il s’agit pour la personne, dans son projet de soins, de prendre conscience de sa maladie, et de s’engager dans la mise en place de nouveaux comportements de santé. La/le soignant.e pourra expliquer la maladie, le traitement, la surveillance et les complications de la maladie. Soignant.e et patient.e négocient les compétences à acquérir. Il faut prendre en compte la situation socio-administrative de la personne et éviter de sur interpréter certaines difficultés ou réticences comme une « résistance » ou « mauvaise adhésion » aux soins.
Intervention éducative. Il s’agit ici d’expliquer la maladie, les mécanismes, le traitement, le bilan, les complications, avec des supports quand cela est possible.
Evaluation des résultats avec des indicateurs précis. Faire le point avec la personne. Mesurer ce qu’elle a compris, si elle a pu appliquer les conseils. Evaluer comment elle s’adapte à sa pathologie. Parfois la personne n’arrive pas à évoluer, et il est alors nécessaire d’analyser la situation avec elle afin de trouver des réponses ensemble pour qu’elle puisse avancer.
La démarche éducative nécessite du temps. En fonction de sa situation, la personne aura peut-être besoin de suspendre ce travail et revenir plus tard pour le continuer. L’ETP vise également à renforcer l’autonomie des patient.e.s pour l’accès à leurs droits et l’orientation dans le système de santé. Cela implique une reprise éducative sur plusieurs mois voire plusieurs années pour certaines personnes.
Approche collective et approche individuelle
L’approche collective privilégie la parole, l’écoute et l’échange. Le but d’une réunion est d’expliquer en détail le programme proposé par les soignant.e.s. Elle permet aux malades de partager leurs expériences. Différents éléments de vulnérabilité individuelle peuvent rendre difficile l’inclusion d’emblée dans une réunion collective, et il est parfois préférable de privilégier dans un premier temps l’approche en individuel. L’animation des groupes est faite par un.e soignant.e formé.e à l’ETP. En cas de constitution de groupes d’auto-support, la réunion est animée par une personne malade également formée à l’ETP, le plus souvent en présence de professionnel.le.s.
Les réunions collectives sont complémentaires des consultations individuelles. Par exemple, pour des personnes atteintes de diabète et suite aux consultations individuelles d’ETP, il peut leur être proposé d’assister à des ateliers collectifs sur la nutrition, de podologie avec un podologue et aux réunions avec un.e patient.e intervenant.e diabétique pour partager leurs expériences de la maladie.
Dans l’approche individuelle il est indispensable de laisser la personne parler de son vécu personnel dans son pays d’origine et/ou en France, et de l’aider à restaurer sa confiance en elle. Le rythme et le contenu des séances sont discutés avec la/le patient.e. La nécessité de suivre des consultations individuelles, avant de participer aux ateliers, est expliquée aux patient.e.s. Certaines personnes peuvent souhaiter éviter les réunions collectives, et l’éducation thérapeutique ne comporte alors que des séances individuelles.
La première consultation individuelle est dédiée au diagnostic éducatif ou BEP. C’est un état des lieux pour mieux comprendre où et comment vit la personne. Il s’agit d’évaluer ensemble une première fois, au début de la démarche, quels conseils elle a pu avoir sur sa maladie et dans quelle mesure elle a pu se les approprier. Si nécessaire, une seconde séance est consacrée au diagnostic éducatif. Le dossier dédié à l’ETP permet de partager ces informations avec l’ensemble des soignant.e.s investi.e.s dans le suivi de la personne.
Les consultations suivantes auront pour but d’expliquer la maladie, le traitement, de mettre en place les objectifs pour améliorer la qualité de vie des personnes et pour qu’elles puissent mieux maîtriser leur maladie. Il est nécessaire de distinguer le cadre de l’ETP et celui des réponses aux demandes de soutien liées au contexte de précarité, effectuées par les autres acteurs de la prise en charge (service social, association etc.). Une deuxième évaluation est proposée six à huit mois après la première consultation, afin d’apprécier l’évolution. A chaque rencontre, un rappel sur la consultation précédente est souhaitable pour que la personne puisse renforcer ses connaissances et son savoir-faire.
La littératie en santé doit être prise en compte (voir encadré). Une personne qui a une faible connaissance des notions de santé risque une fois et demi à trois fois plus d’être exposée à un problème de santé. Le modèle de la littératie en santé et celui de l’ETP sont orientés vers l’apprentissage en tenant compte des capacités de la personne, des ressources mises à disposition et de son environnement social.
Concentrer l’éducation sur l’individu.e signifie que les stratégies doivent également être adaptées à leur niveau de littératie en santé. Quel que soit son niveau de scolarisation, la personne peut avoir des problèmes de compréhension des messages diffusés en santé. S’il s’agit d’une personne non francophone, elle aura un moindre accès aux informations en l’absence de traduction (écrite) ou d’interprétariat (à l’oral). Il est parfois souhaitable de reformuler les phrases pour vérifier ce qui a été compris, et de résumer, classer et synthétiser et aider la personne à prioriser et à faire des choix.
Le terme littératie en santé se rapporte aux connaissances qu’une personne possède dans le domaine de la lecture et de l’écriture qui lui permettront d’être opérationnelle en société. Autrement dit il s’agit de la capacité d’un individu à capter l’information (orale, écrite, graphique, gestuelle, tactile, olfactive), à la traiter et à agir selon ses ressources. L’enjeu est de comprendre, évaluer et utiliser des informations sur la santé qui permettent de maintenir et améliorer la santé. La littératie en santé est considérée comme un déterminant majeur de la santé des populations.
Difficultés et recommandations
Le contexte de l’exil et de la précarité sociale peut perturber le travail sur l’ETP (voir 2. Exil, vulnérabilité et santé) :
- absence d’une protection maladie efficiente (voir 13. Dispositifs de protection maladie et 14. Protection maladie selon le statut) ;
- insuffisance de ressources financières, avec restriction sur les déplacements ;
- dépendance, notamment pour les personnes âgées qui viennent souvent accompagnées aux consultations, avec limitation des déplacements selon la disponibilité des accompagnant.e.s ;
- difficultés d’alimentation : dans l’observation du Comede, une personne sur cinq a connu des restrictions dans ce domaine pour des raisons financières dans les jours précédant la consultation ; en outre il est difficile d’adapter la nourriture à ses problèmes de santé pour les personnes hébergées chez des tiers et/ou qui récupèrent des colis alimentaires auprès d’associations caritatives. Dans un tel contexte, la prise de trois repas équilibrés se révèle impossible et le patient ne prendra pas ses médicaments s’il n’a rien à manger. Les conditions de fabrication des repas dans les hébergements collectifs précaires sont également peu compatibles avec des régimes individuels. La situation est encore plus complexe pour les personnes sans abri. Même si elles sont parfois hébergées dans les hôtels, elles n’ont pas toujours accès à une cuisine ou à un micro-onde. Dans ces conditions avoir deux repas dans la journée est souvent irréalisable ;
- difficultés liées à la pression réelle ou supposée des compatriotes en cas de non-respect de rituels religieux, en dépit des dispenses prévues pour les malades ;
- difficultés liées à l’isolement social et relationnel, et/ou aux troubles psychiques fréquents chez les exilé.e.s dans un contexte de violences multiples. Il est parfois indiqué de suspendre les consultations d’ETP et de proposer le recours au psychothérapeute.
Recommandations pour améliorer l’efficacité de l’ETP :
- pluridisciplinarité : les informations relatives à l’ETP doivent être partagées avec les autres actrices et acteurs médico-sociaux intervenant dans le soin et l’accompagnement du/ de la malade. Selon le guide de l’OMS de 2023, la dimension pluridisciplinaire contribue à la réalisation de cet accompagnement ;
- interprétariat professionnel : indispensable en cas de non partage de la langue avec la personne. Il est souhaitable d’informer l’interprète sur l’ETP avant de commencer ce travail. En pratique, travailler avec le même interprète au cours du suivi est préférable, pour la/le patient.e comme pour la/le professionnel.le ;
- temps d’écoute et de partage : l’annonce d’une maladie chronique peut constituer un traumatisme d’autant plus important que la personne se trouve déjà dans une situation de grande vulnérabilité sociale et administrative. Comme les autres consultations auprès des personnes en situation d’exil, les consultations dédiées à l’ETP doivent intégrer les dimensions de la relation et de la réassurance indispensable pour certain.e.s patient.e.s ;
- situations de co-morbidité : les personnes atteintes de plusieurs pathologies sont parfois suivies par plusieurs médecins spécialistes, en général dans les hôpitaux publics. L’ETP permet de donner les explications sur leurs problèmes de santé, les traitements, dans le même lieu pendant la même consultation si besoin. Une discussion et/ou explication pourra être faite sur tous les médicaments que la personne utilise, et/ou autour des résultats des bilans médicaux ;
- former un.e patient.e pour qu’il/elle devienne une personne ressource/intervenante : à la fois « experte » de sa propre maladie mais également du contexte d’exil, d’exclusion et de précarité, ces personnes ont un rôle déterminant à jouer auprès des autres personnes exilées concernées.
Outils et supports pédagogiques : pour les personnes ayant des difficultés à lire, il est préférable d’utiliser des outils en images. Même pour une personne qui sait lire et écrire, les images aident la personne à comprendre et lui permettent plus facilement de se rappeler des explications qu’on lui donne. Les sources d’outils pédagogiques sont nombreuses. En outre, il peut être utile d’en concevoir et adapter certains selon les contextes (langue et région d’origine, région d’accueil, facteurs de vulnérabilité) aux personnes reçues en consultations et en ateliers collectifs. Ces outils gagnent également à être conçus, évalués et mis à jour avec les personnes concernées.
Livrets de santé bilingues : édités en partenariat entre le Comede et Santé publique France, ces livrets bilingues sont conçus pour aider chacun.e à mieux connaître les principaux enjeux de santé et comprendre le système de protection maladie français, les droits et démarches. Une nouvelle édition est prévue pour 2026.