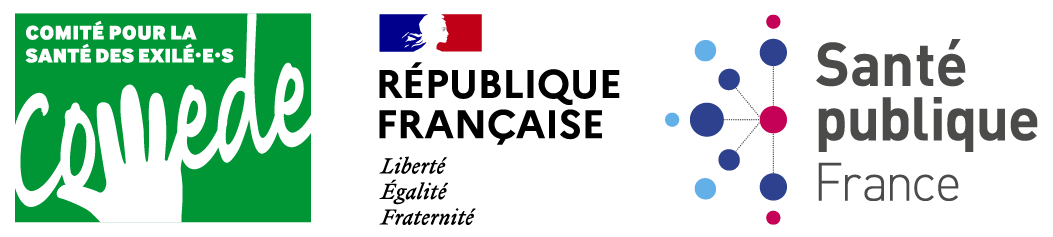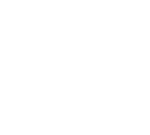18.4. Enfants et adolescents
Santé mentale et troubles psychiques
Article mis à jour le 29 octobre 2025
Le contexte d’exil et de précarité engendre des risques de vulnérabilité psychique chez les enfants de parents exilés et les enfants exilés, qui se cristallisent lors des interactions précoces parents-enfants, au moment de l’entrée dans les apprentissages scolaires et à l’adolescence, voire à l’âge adulte. Pour les enfants et les adolescents ayant connu l’expérience migratoire, il est important de prendre en compte les traumatismes psychiques éventuellement vécus lors de leurs parcours et l’impact potentiel sur leur développement. Pour les Mineurs (étrangers) non accompagnés (MNA), le principe de présomption de minorité est un enjeu majeur dans l’accompagnement et l’accès aux droits pour ces jeunes particulièrement vulnérables. Dans la pratique, le non-respect de ce principe constitue un obstacle dans l’accès aux droits et aux soins, avec un important retentissement psychique.
Ampleur du phénomène et risques psychopathologiques
En 2024, les enfants représentent 30% des 43 millions de réfugiés dans le monde, et 40% des personnes déplacées. Un tiers des réfugiés a été exposé à des guerres, conflits, violences et une série d’expériences qui augmente le risque de troubles psychiques. (UNHCR).
L’environnement social, les facteurs socio-économiques, les relations familiales, les évènements stressants sont des facteurs dynamiques et évolutifs dans la vie d’un enfant. C’est pour cela qu’il faut avoir une approche en santé mentale qui s’étend tout le long du cours de la vie. Les violences et traumatismes du parcours d’exil, les difficultés d’adaptation et les conditions de précarité dans le pays d’accueil, l’exposition au racisme et les politiques de rejet des populations exilées sont autant de facteurs auxquels ces enfants sont confrontés et qui peuvent avoir un impact sur la santé mentale. L’accumulation du stress dûe à l’exposition répétée à des adversités peut conduire à un risque psychopathologique accru.
Les troubles peuvent se manifester durant l’enfance et l’adolescence, mais aussi à l’âge adulte. Certaines phases de l’enfance, notamment les plus précoces, constituent des moments de vulnérabilité majeure, avec un risque d’aggravation d’un trouble du développement. Des interventions précoces qui incluent les services de soins, l’école et le réseau familial et communautaire sont importants à mettre en place. La prise en compte de la famille, du statut administratif, des conditions de vie et des difficultés rencontrées est nécessaire à la prise en soins de ces enfants. L’adolescence constitue un autre moment de particulière vulnérabilité dans la vie d’une personne. Dans l’accompagnement des MNA, il faut considérer l’isolement de ces jeunes ainsi que leur statut légal précaire comme un risque psycho-social. La réflexion autour des déterminants de santé, comme la sécurité, les antécédents de violence vécue, le respect des droits et l’accès aux soins est nécessaire dans la mise en place de travaux de recherche et l’élaboration de dispositifs de soins adaptés à cette population.
Selon la mission nationale mineurs non accompagnés du ministère de la justice, 14 782 MNA ont été confiés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) en 2022, parmi lesquels 6,8% de filles. Ils et elles sont agé.e.s majoritairement de 15 à 17 ans, et viennent d’Afrique de l’Ouest, d’Afrique du Nord et d’Afghanistan. Le nombre d’arrivées de MNA sollicitant une prise en charge à l’ASE est difficile à estimer, en raison des disparités départementales, des mobilités des jeunes et de leur invisibilité lorsque la mise à l’abri n’a pas lieu. Il en est de même pour le nombre de mineurs non reconnus, en recours auprès des tribunaux pour enfants. Selon les associations, 50 à 80% des personnes ayant saisi le juge des enfants voient leur minorité reconnue à posteriori (MDM-MSF 2023). Pour les MNA qui demandent l’asile (1003 en 2023, dont 61% de jeunes afghans), le taux de protection est de 95%.
Exil, périnatalité et précarité : aspects psychologiques
Pour une femme, la grossesse est un passage existentiel dans toutes les cultures, qui implique des remaniements psychiques et représente un moment de transition vers la parentalité. Une fragilité psychologique peut s’exprimer à travers le doute sur ses propres compétences et par un moment de reviviscences de ses propres conflits infantiles et de questionnement sur sa filiation. En situation d’exil, une mère ne trouve pas forcément les étayages externes nécessaires incarnés par la présence des femmes de sa famille et des éléments liés au contexte social et à la culture du pays d’origine, pour soutenir le bouleversement interne inhérent à cette période de transition. D’autant plus si elle est mère isolée, ce qui est souvent le cas. Dans ce contexte, le monde extérieur n’étant pas sécurisant notamment pour les femmes exilées en situation de précarité, la représentation des besoins de l’enfant et des soins peut être complexe.
La structuration psychique de l’enfant se joue pendant ces premières années, lorsque le parent transmet ce qui lui appartient et en même temps, présente le monde aux enfants. Les mères et les pères ont à faire ce double travail de transmission et de présentation du monde qui les entoure, dans un contexte d’exil et de perte des repères. Si elles/ils souffrent de dépression, on peut observer des bébés carencés, insuffisamment stimulés, pouvant manifester des troubles somatiques, et qui sont à risque de développer des difficultés psychiques, comportementales ou un retard développemental. L’absence de sécurité matérielle pour de jeunes parents est un facteur d’insécurité psychique qui peut entrainer des perturbations de la relation mère-bébé. Dans ce contexte, un retard de développement psychomoteur et/ou du langage est parfois visible dès l’entrée à la maternelle. Les enfants jeunes s’exprimant préférentiellement par la motricité, l’agitation psychomotrice vient marquer l’anxiété.
Les troubles parmi les enfants exilés d’âge scolaire
A l’âge de l’école primaire, des difficultés d’apprentissage peuvent être remarquées chez certains enfants exilés, variables selon la possibilité pour l’enfant de mobiliser sa pensée et son envie d’apprendre, son niveau de bilinguisme, et selon les moyens pouvant être mis en œuvre par les parents pour soutenir la scolarité. L’échec scolaire est souvent vécu douloureusement par les enfants et leurs parents, car la perspective d’une scolarité de qualité est vécue comme une réussite de l’ensemble du parcours d’exil. Des troubles du comportement en classe comme de l’agitation, de l’agressivité ou des troubles de l’attention et de la concentration peuvent entraîner des difficultés scolaires. Certains enfants plus introvertis peuvent au contraire exprimer leur souffrance par le repli, l’inhibition et la passivité. Parmi les troubles fréquemment observés chez les enfants exilés, on trouve des troubles du langage isolés ou associés à des troubles des apprentissages et du comportement. Dans certains cas, le trouble du langage se double d’un retard de développement avec des éléments psychopathologiques inquiétants. En contexte bilingue, une évaluation du langage en langue maternelle est recommandée en plus de l’utilisation des outils habituels orthophoniques, psychométriques et psychologiques.
L’expression du trauma chez l’enfant. Un grand nombre d’exilés, en particulier les demandeurs d’asile, ont vécu des événements traumatiques dans leur pays d’origine (voir 17 Violence et santé) et leur parcours migratoire a souvent été complexe et dangereux. Fragilisées par les évènements pré-migratoires et le sentiment d’insécurité lié à la précarité de la vie en France, les familles sont parfois mises à mal dans leur fonction de protection et de contenance auprès des enfants. Les conditions de la migration sont donc importantes à prendre en compte pour évaluer les répercussions psychiques chez les enfants et les adolescents des événements traumatiques éventuellement subis par les parents en présence ou non de leurs enfants. Compte tenu de l’exil vécu et des facteurs environnementaux, il est important de repérer les éventuels signes d’expression du trauma chez l’enfant, afin de pouvoir proposer un accompagnement psychologique adapté. Du point de vue de la symptomatologie post-traumatique chez l’enfant, on observe des manifestations de reviviscence à travers le jeu et les cauchemars. Il peut y avoir également une tristesse avec perte de l’envie de jouer, un état de prostration ou d’alerte avec attitude d’agrippement, d’évitement phobique ou de comportements régressifs (pertes d’acquisitions antérieures langagières ou comportementales) pouvant nuire à l’autonomisation et au développement de l’enfant. L’expression somatique des troubles est fréquente, avec des atteintes cutanées, des douleurs.
Pour les enfants au-delà de 6 ans, le trauma peut se manifester par une sidération psychique marquée par une impossibilité ou un retard d’apprentissage notamment linguistique, ainsi qu’une difficulté à investir le monde extérieur. Des comportements agressifs à l’école, une anxiété devant l’inconnu et des cauchemars répétitifs peuvent également être des signes de troubles liés au traumatisme. Une forme d’hypervigilance et d’hypermaturité chez les enfants plus âgés peut être observée, dans un souci constant par rapport à la situation de leur famille. L’exposition sur le long terme à des événements stressants mineurs, mais répétitifs, peut également avoir un effet traumatique. Au delà d’un seuil de tolérance variable d’un enfant à l’autre, ses capacités d’adaptation deviennent inopérantes. Il ne s’agit pas forcément d’un événement traumatique unique qui sidère la pensée par sa violence et la sensation intense de danger de mort, mais plutôt des effets des traumatismes répétés pouvant provoquer de graves troubles du développement et de la personnalité chez l’enfant. Le climat d’insécurité matérielle et psychique dans lequel vivent parfois ces familles durant des années, le non respect des droits fondamentaux de l’enfant (droit d’être protégé, soigné, de vivre en famille) peuvent provoquer des effets traumatiques à long terme. Les effets de ce traumatisme sont très variables d’un enfant à l’autre et dépendent de sa résilience, de la dynamique familiale et de la place qu’il occupe au sein de la famille.
L’adolescence en exil et les Mineurs non accompagnés
La puberté propulse l’enfant dans la période de l’adolescence, temps de transformations et de reviviscences des conflits internes, qui permettra le développement de l’identité propre. La construction identitaire à cette période du développement va se faire chez l’adolescent.e exilé.e dans le contexte d’un double vécu d’étrangeté : étranger.e à lui/elle-même par les modifications biologiques et psychologiques liées à la puberté ainsi qu’étranger.e au nouvel environnement du pays d’accueil. L’adolescent.e exilé.e est un.e adulte en devenir à considérer dans son parcours migratoire, pris entre filiation et affiliations, avec une construction identitaire nécessairement cosmopolite. La recherche de son identité propre et la construction d’assises narcissiques suffisamment sûres nécessitent un travail d’élaboration sur sa place dans la filiation et sur son histoire familiale marquée par l’exil. Si ce processus échoue, les passages à l’acte peuvent survenir avec des comportements antisociaux, des conduites à risque et un possible développement de conduite addictive, associés souvent à un sentiment d’impasse.
La santé mentale des mineurs non accompagnés, effets des ruptures, de la violence et de l’exclusion. Entre 2017 et 2023, le Comede et Médecins sans frontières ont assuré la prise en soins psychologiques de Mineurs non accompagnés en recours, au sein du Centre d’accueil de jour géré par MSF à Pantin (93). Cette action a notamment conduit à la rédaction d’un rapport en 2021, permettant de caractériser les troubles psychiques et d’en quantifier l’ampleur. Ces jeunes exilé.e.s souffrent principalement de troubles réactionnels à la précarité (50%), de syndromes psychotraumatiques (37%) et de dépression (12%). Ce rapport rend également compte des difficultés majeures d’accès aux soins de santé mentale pour ces jeunes et les mauvaises conditions d’accueil, le manque de protection, jusqu’à des formes de maltraitance institutionnelle.
Modalités de prise en soins psychologique des enfants et adolescents migrants
Pour les enfants de moins de 3 ans présentant des signes de souffrance psychique ou de pathologie psycho-fonctionnelle liée à un évènement traumatique ou non, il est important de proposer aux parents des possibilités d’accompagnement dans un cadre sécurisant. Les structures de Protection maternelle et infantile (PMI) sont adaptées à ce type de prise en charge.
Pour les enfants d’âge préscolaire, scolaire et les adolescents présentant des troubles psychiques, il est possible de les adresser au Centre médico-psychologique de secteur (CMP) ou au Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) le plus proche. La/le psychologue ou l’infirmier.e.s scolaire peut jouer un rôle important dans le repérage des troubles à l’école et l’orientation vers des structures d’accompagnement spécialisées. L’enfant peut y bénéficier d’un accompagnement psychothérapeutique individuel avec un.e psychologue et/ou d’une participation à un groupe thérapeutique et si besoin de l’intervention d’autres professionnels de l’équipe pluridisciplinaire (orthophoniste, psychomotricien, éducateur spécialisé). Le recours à un.e psychologue permet de proposer un cadre afin que l’enfant puisse élaborer autour de son histoire individuelle et familiale. Dans le cas de troubles psychiques plus importants, l’enfant peut être suivi également par un pédopsychiatre.
Les adolescents peuvent également être adressés vers les Maisons des adolescents présentes dans chaque département. Il s’agit de lieux polyvalents où la santé des jeunes est considérée à la fois dans sa dimension physique, psychique, relationnelle et sociale, éducative.
Pour les enfants et adolescents allophones, le recours à l’interprétariat professionnel est nécessaire lors des consultations individuelles et familiales. Dans certains cas particuliers, le recours à une orientation de deuxième intention vers une consultation transculturelle peut être utile, afin de proposer un dispositif qui prendra en compte la dimension culturelle de la problématique rencontrée par la famille.