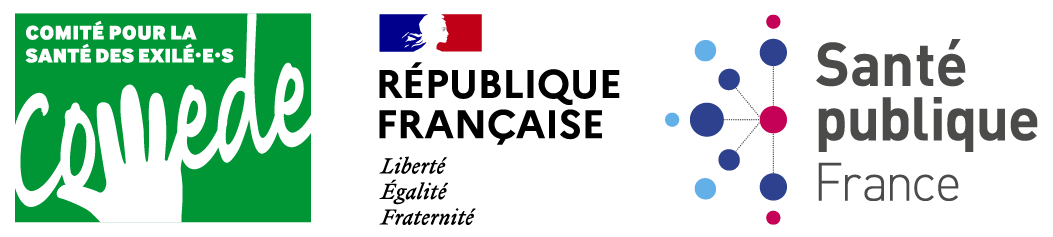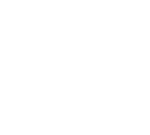6.3. En préfecture, procédure normale
Droit d’asile
Article mis à jour le 03 décembre 2024
La personne qui souhaite demander une protection internationale en France ne peut pas saisir directement l’Ofpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides). Elle doit préalablement se signaler à l’autorité préfectorale compétente. La procédure est commune à toutes les formes de protection demandées (statut de réfugié.e et protection subsidiaire), sans que la personne ait besoin de plus de précision dans sa demande. Il faut s’adresser à une structure de premier accueil (Spada ou Caes), avant de pouvoir accéder au Guichet unique des demandeurs d’asile (Guda).
Pré-enregistrement de la demande, Spada, CAES et SAS
La Structure de premier accueil des demandeurs d’asile (Spada) constitue un pré-enregistrement de la demande. Les modalités d’accès varient selon la région concernée. Par exemple en Ile-de-France, il faut au préalable appeler une plateforme téléphonique gérée par l’Ofii (Office français de l’immigration et de l’intégration), pour obtenir un rendez-vous en Spada, ce qui constitue une étape supplémentaire. L’accès à cette plateforme téléphonique (payante pour l’appelant.e) est variable et peut considérablement allonger les délais d’accès à la procédure et par conséquent aux conditions matérielles d’accueil.
Le rôle de la Spada est de :
- donner une information sur la demande d’asile ;
- remplir le formulaire électronique d’enregistrement de la demande d’asile avec les indications d’état civil, de composition de la famille, du parcours d’exil, des modalités d’entrée en France (visa)… ;
- prendre une photo d’identité par webcam ;
- prendre un rendez-vous au Guichet unique des demandeurs d’asile (Guda) dans un délai théorique de trois à dix jours maximum (il peut arriver que ce délai ne soit pas respecté) ;
- et remettre la convocation pour le rendez-vous au Guda.
Les Centres d’accueil et d’examen de situation (CAES) sont intégrés au schéma national d’accueil en tant que prise en charge de premier niveau. Ils permettent une mise à l’abri avec un hébergement temporaire (1 mois) le temps de l’examen de la situation. Au terme de cet examen, une orientation vers d’autres dispositifs est proposée en fonction de la situation de la personne. Le CAES dispose d’un accès direct à la prise de rendez-vous en Guda.
Les SAS d’accueil temporaire régionaux. Ce dispositif créé par la circulaire du 13 mars 2023 prévoit l’orientation des personnes pour un accueil et un hébergement pendant 3 semaines avec l’objectif de procéder à une évaluation sanitaire et sociale comprenant l’ouverture des droits sociaux et un examen de la situation administrative conduisant à une orientation vers un « dispositif approprié ».
Guichet unique des demandeurs d’asile et conditions matérielles d’accueil
Si la France n’est pas responsable de la demande d’asile, la personne se verra appliquer le règlement européen Dublin III et sera placée en procédure dite « Dublin » (voir 6.5. En préfecture, procédure Dublin).
Si la France est responsable de la demande d’asile, celle-ci pourra relever de deux types de procédures qui en définissent les conditions d’examen : la procédure normale ou la procédure accélérée (voir 6.4). Ces deux procédures donnent lieu à la remise du formulaire Ofpra. La personne dispose d’un délai de 21 jours (sauf en cas de réexamen où le délai est de 8 jours), à la date de la remise de l’attestation de demandeur d’asile (ATDA), pour adresser à l’Ofpra son dossier complet avec son récit de vie en français en lettre recommandée avec AR. Le formulaire doit être signé et accompagné de la photocopie de l’ATDA, de deux photos, le cas échéant des originaux des documents d’identité en possession de la personne (ceux-ci seront remis en cas de rejet de la demande), ainsi que tout document utile.
Avec le formulaire Ofpra, la personne se voit aussi remettre :
- le Guide du demandeur d’asile https://www.immigration.interieur.gouv.fr/fr/Asile/Guide-du-demandeur-d-asile-en-France ;
- la notice « double demande » : le droit prévoit que lorsqu’une personne enregistre une demande d’asile et que celle-ci relève de la compétence de la France, elle doit, dans un délai imparti, faire valoir les autres motifs de régularisation dont elle pourrait relever et notamment les motifs médicaux (voir 8.1. Repères fondamentaux) ;
- une notice d’accès au portail Ofpra : depuis le 2 mai 2022, l’espace numérique personnel et sécurisé Ofpra est généralisé dans l’hexagone permettant la télétransmission de l’ensemble des courriers. Les personnes en procédure Dublin et les mineur.e.s non accompagné.e.s, ne sont pas concernées. Il est possible de demander d’en être dispensé si la personne n’est pas matériellement en mesure d’accéder à ce portail ou en cas de situation particulière ou de vulnérabilité.
Au Guda, la personne sera également reçue par l’Ofii, lors d’un entretien individuel où lui sera proposée l’offre de prise en charge. En cas d’accord, celle-ci donnera lieu à l’ouverture des Conditions matérielles d’accueil (CMA). Cet entretien donne lieu à la détection de la vulnérabilité pour notamment déterminer les « besoins particuliers d’accueil » (art L522-1 et 3 Ceseda). La personne se voit également informée de la possibilité de bénéficier d’un examen de santé gratuit. En cas de problème de santé, un formulaire de certificat médical lui est remis, à faire remplir par un médecin, pour transmission sous pli confidentiel au médecin de zone de l’Ofii.
Attention : Le décret du 16 juillet 2024 confirme la modification de la procédure et la mise en place progressive de pôles territoriaux appelés « France asile ». Ces pôles comprennent les agents de la préfecture, de l’Ofii et de l’Ofpra. La nouveauté tient à la présence des agents de l’Ofpra qui auront comme mission de fixer l’état-civil, le choix de la langue pour l’entretien, recueillir via un formulaire dématérialisé quelques éléments pour cibler la demande, donner les codes d’accès au coffre-fort électronique où sera envoyé la lettre d’introduction et la convocation pour un entretien.
Les Conditions matérielles d’accueil peuvent inclure :
- le versement de l’Allocation de demandeur d’asile (Ada), qui prend fin au terme du mois où la personne s’est soit vue reconnaître une protection, soit a perdu son droit à se maintenir sur le territoire français suite au rejet définitif de sa demande d’asile. Cette allocation est soumise à des conditions (avoir 18 ans révolus, des ressources mensuelles sur les 12 mois précédents inférieurs au montant du RSA, avoir envoyé son dossier Ofpra dans le délai imparti). Elle comprend un montant forfaitaire de 6,80 € par jour pour une personne seule, auquel s’ajoute un montant supplémentaire en cas de défaut d’hébergement, quel qu’il soit (chez un tiers, au 115, etc.). Le montant prend en considération la composition du foyer ;
- une solution d’hébergement (intégrée au schéma national d’accueil), à défaut de laquelle la personne sera réorientée vers la Spada pour une domiciliation postale. Il existe différents types d’hébergement pour les personnes en demande d’asile : Huda (Hébergement d’urgence des demandeurs d’asile), Cada (Centre d’hébergement des demandeurs d’asile), AT-SA (accueil temporaire-service asile). Les différences entre ces dispositifs sont liées au taux d’encadrement dédié à l’accompagnement social et juridique. Dans la pratique, un certain nombre de personnes doivent avoir recours au Samu social « 115 », et certaines se retrouvent sans solution, à la rue ;
Attention :
le droit prévoit une répartition des hébergements sur l’ensemble du territoire donnant lieu à des orientations en région. Ces orientations s’inscrivent dans le schéma national et régional d’accueil, qui est un outil de gestion des places d’hébergements dédiées aux personnes protégées ou en cours de procédure asile. Ce schéma « fixe la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ainsi que la répartition des lieux d’hébergement », voir en ce sens l’art L744-2 Ceseda. Lors de son passage à l’Ofii, la personne se voit proposer cette orientation. En cas d’acceptation, elle est orientée vers un centre d’accueil (CAES) qui peut se trouver dans une autre région qui deviendra alors compétente pour la gestion de la demande d’asile. La personne devra rejoindre cette région dans un délai imparti et ne pourra quitter le lieu sans autorisation préalable, au risque de perdre les CMA. En cas de refus, la personne se voit refuser les CMA. Les modalités de refus ou de cessation des CMA, qu’elles soient partielles ou totales, sont encadrées par le droit (art L551-15 et 16 Ceseda). En cas de cessation, il est possible de faire un recours gracieux auprès de l’Ofii et/ou d’un recours juridique devant le tribunal administratif. Il est alors conseillé de faire appel à une association spécialisée ou un.e avocat.e.
Voir note pratique du Comede Conditions matérielles d’accueil des personnes en demande d’asile- Recours contre les décisions de refus ou retrait
- l’assurance maladie et la complémentaire santé solidaire (C2S). La personne peut ouvrir droit à ces prestations sous réserve d’une condition de 3 mois d’ancienneté de présence sur le territoire français à compter de sa date d’arrivée et si elle est en mesure de pouvoir en attester (voir 13.3). À défaut de protection maladie et en cas de problème de santé, l’hôpital qui délivre les soins nécessaires doit mettre en œuvre le Dispositif soins urgents et vitaux avec dispense de produire un refus d’aide médicale d’Etat (voir 12.3). À noter que la prise en charge des frais de santé n’est pas conditionnée à l’acceptation de l’offre de prise en charge ;
- Le droit au travail peut être autorisé à la personne sous réserve de l’opposabilité du marché du travail dans la région où elle se trouve (art L554-3 Ceseda) et si l’Ofpra, à la date d’introduction du dossier, n’a pas statué dans les 6 mois sans que ce retard ne soit imputable à la personne. Cette demande se fait auprès de la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi), elle sera examinée en fonction des métiers en tension (Liste des métiers en tension).
Suite de la procédure normale
Dans l’hexagone, la procédure normale ne prévoit aucune restriction. La personne bénéfice d’une attestation de demandeur d’asile de 10 mois qui est renouvelable par période de 6 mois et l’autorisera à se maintenir sur le territoire pendant le temps de l’instruction de la demande par l’Ofpra et la CNDA (voir 6.1. Repères et panorama). L’Ofpra dispose de 6 mois pour procéder à l’examen de la demande, mais ce délai peut être prolongé pour des raisons indépendantes de la personne. Dans ce cas, elle reçoit un courrier l’informant du report de ce délai. En cas de rejet de l’Ofpra, le recours à la CNDA est suspensif.
En Guyane, le droit a prévu des mesures dérogatoires, notamment celle de pouvoir mettre en place, par voie d’arrêté ministériel (pour une période maximum de 18 mois renouvelable) des dispositions spécifiques en cas de forte augmentation des demandes d’asile :
- concernant la procédure d’asile, la personne doit se présenter sans rendez-vous à la Croix-Rouge française à Cayenne (Spada), que ce soit à la suite d’une injonction à demander l’asile (48 à 72h) délivrée par la PAF, ou d’une convocation délivrée par la sous-préfecture de Saint Laurent du Maroni. Dès la remise de l’ATDA, la personne dispose de 7 jours pour remettre son dossier complet à l’antenne de l’Ofpra de Cayenne. Lors du rendez-vous à l’Ofpra (délivré lors de son passage à la Spada), la personne se voit remettre la lettre d’introduction (prouvant le dépôt et l’instruction de la demande d’asile), la convocation pour l’entretien à l’Ofpra (l’Ofpra ayant 15 jours pour procéder à l’examen de la demande), et la convocation pour la remise de la décision en main propre ;
- en matière d’hébergement, le territoire guyanais dispose seulement de places en Huda. Initié en 2022, un appel à projet prévoit la pérennisation des places avec une répartition sur l’ensemble du département. Alors que le coût de la vie est plus élevé en Guyane que dans l’hexagone, l’allocation y est réduite, avec un montant forfaitaire de 3,80 € et un montant additionnel de 4,70 € en l’absence d’hébergement. Le renouvellement de l’ATDA se fait par voie électronique en s’adressant à la préfecture.
Situations spécifiques aux mineur·es
L’enfant ou le jeune accompagnant un de ses parents lui-même demandeur d’asile. Le droit prévoit que la demande d’asile est regardée comme étant présentée au nom des parents et de l’enfant. Pour le versement de l’Ada, ce sont donc les parents qui recevront le versement en tant que représentants légaux de l’enfant (Conseil d’État du 20 décembre 2019, n°436700). En dépit du droit et des décisions en ce sens de certains tribunaux administratifs, il arrive que les pratiques de l’Ofii n’appliquent pas ces dispositions. Il est dans ce cas toujours possible de faire un recours. Par ailleurs, un des motifs invoqués pour protéger une enfant est le risque de mutilations sexuelles féminines (voir 17.3). Cela concerne les mineures nées en France ou à l’étranger. Lors de l’instruction de la demande, il faut fournir un certificat médical de non-excision (délivré par un médecin d’une unité médico-judicaire, arrêté du 23 août 2017). Si la protection est accordée sur ce motif, le certificat médical sera à renouveler tous les 3 ans.
L’enfant ou le jeune mineur isolé. Une personne mineure non accompagnée (MNA) étant considérée juridiquement incapable, elle ne peut seule entamer de démarche. Le droit prévoit que si une personne mineure se présente pour enregistrer sa demande d’asile, l’autorité compétente doit procéder à l’enregistrement puis signaler sa situation au procureur de la République en vue de la désignation d’un administrateur ad hoc afin qu’elle soit représentée, et au Président du Conseil général afin qu’elle soit prise en charge au titre de l’Aide sociale à l’enfance (ASE). En pratique, un.e MNA qui souhaiterait déposer une demande d’asile est orientée en fonction des départements vers le Conseil général ou une plateforme d’évaluation de minorité et de mise à l’abri temporaire. Ce dispositif prévoit un accueil provisoire le temps d’établir la minorité et l’isolement de la personne. La loi du 7 février 2022 a fixé un nouveau cadre sur l’accueil temporaire des MNA, défini à l’art L221-2-4 du Code de l’action sociale et des familles. Dans l’attente des décrets d’application, se référer à l’arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l’article R.221-11 du CASF concernant les modalités de cet accueil.
Selon la reconnaissance de la minorité. Si la personne est reconnue mineure, elle sera alors prise en charge par l’ASE. En tant que représentante, l’ASE pourra l’aider dans le dépôt de sa demande d’asile. Si la personne est déclarée majeure, elle se verra notifier une décision de refus de prise en charge mentionnant les voies et délais de recours, et il sera mis fin à l’accueil provisoire. Pour déposer un recours, se rapprocher d’une association spécialisée ou d’un.e avocat.e. La non-reconnaissance de minorité a comme conséquence de priver la personne mineur.e des moyens de protection liés à son statut et de la placer dans une parenthèse administrative plus ou moins longue de « ni-ni » (ni mineur.e, ni majeur.e), avec des conséquences notamment en matière d’accès aux soins et à l’hébergement.