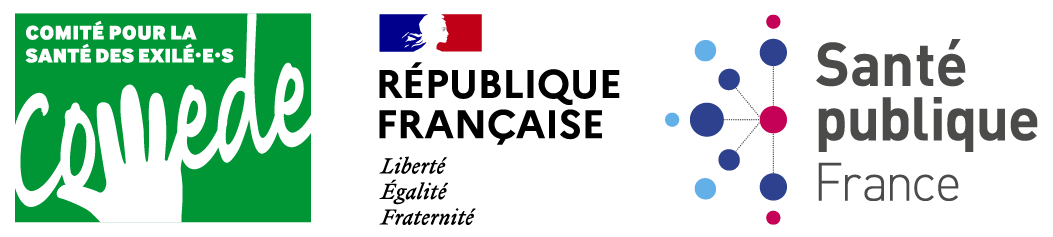6.5. En préfecture, procédure Dublin
Droit d’asile
Article mis à jour le 11 mars 2025
Si la Convention de Genève du 28 juillet 1951 définit les modalités selon lesquelles un Etat doit accorder une protection internationale aux personnes qui en font la demande ; le droit d’asile s’inscrit également dans une dimension européenne. Le règlement dit « Dublin III » fixe le pays responsable de la demande d’asile, et définit les modalités selon lesquelles la personne doit y déposer sa demande. Le pays responsable est théoriquement le premier pays « atteint » par la personne, mêmes si des dérogations parfois possibles notamment pour assurer la continuité des soins de personnes accueillies et soignées dans un autre pays membre de l’Union Européenne.
Attention : adopté le 10 avril 2024 par le parlement européen, le pacte sur la migration et l’asile prévoit une série de textes (9 règlements et 1 directive) qui viennent instaurer une nouvelle politique migratoire et de l’asile sur le territoire européen. En 2026, il ne sera plus question de règlement Dublin mais du règlement de migration et de l’asile, et il est probable que de nouvelles réformes viendront modifier les dispositions actuelles.
Les différentes étapes de la procédure Dublin
Le règlement Dublin III prévoit qu’une personne ne peut pas avoir le choix du pays dans lequel, elle souhaiterait déposer sa demande d’asile, et qu’un seul pays est responsable d’une demande d’asile. Le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 détermine les différents critères selon lesquels un Etat membre de l’Union européenne (UE) est responsable d’une demande d’asile. Ce règlement s’impose aux Etats membres sans qu’il y ait besoin d’une transposition en droit interne. Comme les autres Etats européens, la France est tenue d’appliquer ce règlement, et doit également respecter le droit international, notamment fixé par la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). La procédure Dublin s’applique à toute personne présente sur le territoire français, ou qui serait maintenue en zone d’attente.
Préalable : pré-enregistrement et enregistrement de la demande. Avant d’arriver à la détermination de la procédure, la personne devra au préalable passer par une étape de pré-enregistrement : la Structure de premier accueil des demandeurs d’asile (Spada), puis d’enregistrement en se présentant au Guichet uniquement des demandeurs d’asile (Guda). Pour plus d’informations sur ces étapes, voir 6.3. En préfecture, procédure normale.
Détermination de la procédure selon la prise d’empreintes digitales. L’étape qui va déterminer la mise en œuvre du règlement Dublin III est celle de la prise d’empreintes. En pratique, c’est lors du passage au Guichet unique des demandeurs d’asile (Guda), à l’étape de la présentation au guichet de la préfecture qu’est réalisée cette prise d’empreintes. Les empreintes digitales sont alors comparées à celles déjà enregistrées dans les fichiers :
- Eurodac, fichier qui recense toutes les personnes ayant déposé une demande d’asile dans l’UE, ou ayant franchi irrégulièrement les frontières ;
- Visabio, fichier qui recense les visas obtenus dans un pays de l’UE.
La personne sera placée en procédure Dublin par la préfecture si ses empreintes sont déjà existantes dans l’un des fichiers, ou s’il existe toute autre preuve d’un passage préalable dans un autre Etat européen lors de l’entretien en Guda. Dans le langage courant, on parlera d’une personne « dublinée ». Sa demande d’asile ne pourra être introduite en France et il ne lui sera pas remis de formulaire Ofpra pour l’examen au fond de sa demande d’asile. Malgré tout, la personne pourra se maintenir sur le territoire français jusqu’au transfert effectif (à ne pas confondre avec une mesure d’éloignement telle qu’une Obligation à quitter le territoire).
Remise d’une attestation de demandeur d’asile (ATDA) et convocations régulières en Préfecture. Cette attestation mentionne la procédure Dublin en cours, et elle est renouvelable tous les 4 mois jusqu’à la mise en œuvre, par la préfecture, du transfert effectif vers l’Etat membre responsable. La personne doit recevoir, le même jour, une notice d’informations dans sa langue sur les différentes étapes de la procédure Dublin. Elle doit l’informer sur ses obligations et ses droits comprenant le droit aux conditions matérielles d’accueil ainsi que les informations sur les organisations assurant une aide et une assistance aux demandeurs d’asile. Depuis 2015, une circulaire donne pour consignes aux préfectures « d’appliquer Dublin par tout moyen ». Des moyens coercitifs ont ainsi été mis en oeuvre : placements en Centre de rétention, assignations à résidence, création d’hébergements spécifiques, placement « en fuite » (voir infra). Un Arrêté du 10 mai 2019 a mis en place des pôles régionaux Dublin qui ont pour mission la gestion de cette procédure.
L’entretien individuel à la préfecture. Il est prévu qu’un entretien confidentiel soit mené, dans une langue « dont on peut raisonnablement supposer » que la personne la comprenne et la parle. Cet entretien permet un examen de la situation de la personne. Il doit également prendre en considération les éléments de vulnérabilité (art. L571-1 du Ceseda). Cet entretien donne lieu à un compte rendu ou rapport dont une copie est remise à la personne.
Les Conditions matérielles d’accueil (CMA) sont gérées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii). Lors du passage au Guda, la personne se voit proposer l’offre de prise en charge, qu’elle doit accepter si elle veut pouvoir bénéficier de ces CMA. Attention : depuis la réforme de 2018, le droit prévoit qu’une personne puisse être orientée dans une autre région. S’y soustraire revient à perdre le bénéfice des CMA. La personne se verra alors refuser le maintien de la domiciliation, le refus renouvellement de l’ATDA et perdra le versement de l’allocation (Ada). Concenant le maintien de la domiciliation, un recours peut être tenté et il convient alors de se rapprocher d’une association spécialisée ou d’un.e avocat.e. Les CMA sont susceptibles d’inclure :
- le versement de l’Allocation de demandeur d’asile qui prend fin à compter de la date du transfert effectif à destination de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile ;
- une domiciliation postale ou un hébergement ;
- l’assurance maladie et à la Complémentaire santé solidaire (C2S) (carence de 3 mois d’ancienneté de présence en France avec possibilité de prise en charge des soins hospitaliers par le DSUV, voir 12.3.). NB : le droit à la protection maladie n’est pas conditionnée à l’acceptation de l’offre de prise en charge.
Hébergement : si le droit n’opère aucune distinction, en pratique les personnes se retrouvent hébergées en Huda (Hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile), CAO (Centre d’accueil et d’orientation), ou Pradha (programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile). Toutefois en 2024, ces hébergements ne suffisent pas pour répondre aux besoins de l’ensemble des personnes en cours de procédure, et certaines doivent avoir recours au 115 ou sont contraintes de vivre dans des camps.
Dérogations, détermination et recours
La clause de souveraineté. Chaque Etat conserve la possibilité d’examiner une demande d’asile, même si celle-ci relève de la responsabilité d’un autre Etat membre.
Les dérogations à la procédure Dublin. Chaque Etat peut, sur le principe de la clause de souveraineté, déroger à l’application du règlement Dublin III pour des motifs familiaux (unité de famille), des motifs de vulnérabilité (dépendance nécessitant l’assistance d’un tiers) ou en raison de l’état de santé. Il est donc possible pour des raisons de santé de solliciter cette dérogation. Cependant, cela requiert l’avis d’un médecin qui devra apprécier la nécessité d’une prise en soins, le risque en cas de rupture de soins, et l’incompatibilité du voyage avec l’état de santé en cas de transfert vers un autre pays membre de l’UE et parfois dans l’hypothèse d’un retour dans le pays d’origine de la personne suite à une mesure d’éloignement prononcée par le pays de transfert (« expulsion par ricochet »). Cette demande de dérogation à Dublin en raison de l’état de santé ne doit pas être confondue avec une demande de titre de séjour pour raison médicale (voir 7. Droit au séjour pour raison médicale et 15.3. Certification médicale et droit au séjour) Dans la pratique, il arrive que les préfectures ne tiennent pas compte de ces demandes au détriment de la continuité des soins (voir recours infra).
La péremption de la responsabilité. Les dispositions du règlement Dublin sont caduques si la personne :
- est titulaire d’un titre de séjour en France pour un motif autre ;
- a effectué depuis lors un séjour hors de l’espace de l’Union européenne pendant plus de 3 mois avec preuves de ce séjour ;
- est déboutée de sa demande d’asile et a quitté l’espace de l’Union européenne (UE 27 + Islande, Suisse, Norvège, Liechtenstein), que le départ soit volontaire ou forcé. Elle devra alors produire des preuves de ce départ.
Les critères de détermination. Le règlement Dublin a prévu une hiérarchie de critères pour aider à la détermination de l’Etat responsable de la demande :
- la minorité (présence famille, sœur, frère en séjour régulier dans un autre Etat membre et en mesure de s’en occuper) ;
- la présence de membres de familles bénéficiaires d’une protection internationale ;
- la présence de membres de familles demandeurs d’une protection internationale ;
- la délivrance d’un titre de séjour ou de visa ;
- l’entrée et/ou le séjour ;
- l’entrée sous exemption de visa ;
- une demande d’asile présentée en zone d’attente (voir 6.2. A la frontière).
Les délais de la procédure Dublin : selon la situation, il s’agit soit d’un mécanisme de « prise en charge » (mécanisme de réadmission) soit de « reprise en charge » (mécanisme appliqué aux personnes ayant déjà été demandeuses d’asile dans un autre pays).
| Délai de saisie de l’Etat responsable | Délai de réponse | Délai de transfert (art. 29) | |
| Prise en charge (art. 21.22) | 3 mois à compter de la présentation en préfecture. Délai réduit à 2 mois si signalement positif Eurodac | 2 mois, l’absence de réponse vaut accord implicite |
– 6 mois dès réponse explicite ou implicite – 12 mois en cas d’emprisonnement – 18 mois en cas de fuite |
| Reprise en charge (art. 23.24) | 2 mois si signalement Eurodac et 3 mois pour autres motifs | 1 mois, sauf signalement Eurodac, délai de 15 jours | Identiques |
Dès acceptation par l’Etat membre saisi (qu’elle soit explicite ou implicite), la personne se voit notifier par écrit une décision de transfert et le refus d’examiner sa demande de protection par la France. Cette décision appelée Arrêté de transfert prévoit les délais et voies de recours, la mise en œuvre du transfert et mentionne si nécessaire la date et le lieu où la personne doit se rendre dans le cas où elle s’y rend par ses propres moyens. La France dispose d’un délai de six mois pour exécuter la décision de transfert à compter de la date d’acceptation de l’Etat responsable. Cette date est obligatoirement indiquée sur l’Arrêté de transfert.
Attention : le droit prévoit la possibilité d’assigner à résidence ou de placement en rétention en vue de garantir la procédure de transfert. Il n’est cependant pas possible de transférer une personne vers un pays dont les défaillances systémiques dans la procédure de demande d’asile et les conditions matérielles d’accueil sont reconnues (art. L572-3 du Ceseda), et qui pourraient dès lors constituer « un traitement inhumain et dégradant », comme c’est notamment le cas pour la Grèce depuis 2011.
La notion de fuite. Si la personne tente de se soustraire à deux convocations, ou à l’exécution du transfert, alors même qu’elle est en informée préalablement, elle est alors considérée « en fuite ». Seule la jurisprudence a permis de donner un contour à cette notion de fuite : non présentation aux convocations, refus de se soumettre à un test PCR, non présentation aux convocations avec ses enfants, refus d’embarquer etc. Le placement en fuite a pour conséquence la perte des CMA, et la prolongation du délai de transfert de 12 mois supplémentaires. Cette situation place la personne dans une parenthèse administrative d’attente et sans perspectives d’amélioration de ses conditions de vie, ce qui risque de retentir sur son état de santé.
Le recours contre la décision de transfert. La notification de l’arrêté de transfert peut être :
- simple, sans assignation à résidence et sans placement en centre de rétention (CRA). Le recours peut alors être introduit auprès du tribunal administratif (TA) dans un délai de 7 jours à compter de la date de notification de la décision ;
- assortie d’une assignation à résidence ou d’un placement en CRA. Le recours doit alors être déposé dans un délai de 48h à compter de la date de notification de la décision.
Il faut évaluer l’opportunité d’un recours au regard de la situation de la personne (date de début de la procédure, présentation aux convocations, etc.) car en cas de rejet du TA, le délai de de 6 mois de transfert redémarre à zéro à la date de la décision du tribunal. Attention : le recours seul contre l’assignation à résidence a les mêmes effets en terme de prolongation du délai d’exécution. Le recours est suspensif. La personne a le droit à l’assistante d’un.e avocat.e et d’un.e interprète.
A l’expiration du délai de transfert. La France devient alors responsable de la demande d’asile et doit délivrer à la personne une attestation en procédure normale, voir 6.3. En préfecture, procédure normale. Cependant, il arrive que les préfectures délivrent une attestation en procédure accélérée. Si cela permet à la personne de se maintenir en France et de saisir l’Ofpra, cette procédure a aussi pour conséquences de la priver des CMA. Il est possible de déposer un recours contre cette décision, avec l’aide d’une association ou d’un.e avocat.e. Pour plus de détails sur les modalités de recours voir la note pratique de 2024 Conditions matérielles d’accueil (CMA) des personnes en demande d’asile, Recours contre les décisions de refus ou retrait en ligne, sur le site du Comede, ici.
Retour en France après l’exécution du transfert. Il peut arriver que la personne revienne en France après l’exécution du transfert. Si la personne se représente au Guda, la préfecture peut soit refuser d’enregistrer la demande, soit la placer à nouveau en procédure Dublin, refaisant partir la procédure à zéro (saisine Etat responsable, décision de transfert). Durant cette nouvelle procédure, la personne ne bénéficiera pas des CMA, l’Ofii considérant qu’il s’agit d’un réexamen ou d’une fraude.
Dublin et état de santé. Une personne sous procédure Dublin n’est pas concernée par la procédure dite de « double demande » prévu par l’article L431-2 du Ceseda (Voir 8. Double demande asile et maladie). Cependant rien, dans la loi, n’interdit à une personne sous le coup d’une procédure Dublin de déposer simultanément une demande de titre de séjour pour raison médicale (que ce soit avant, pendant ou après la notification de l’arrêté de transfert), sous réserve que la personne remplisse les deux conditions médicales du droit au séjour pour raison médicale (voir 15.3. Certification médicale et droit au séjour).