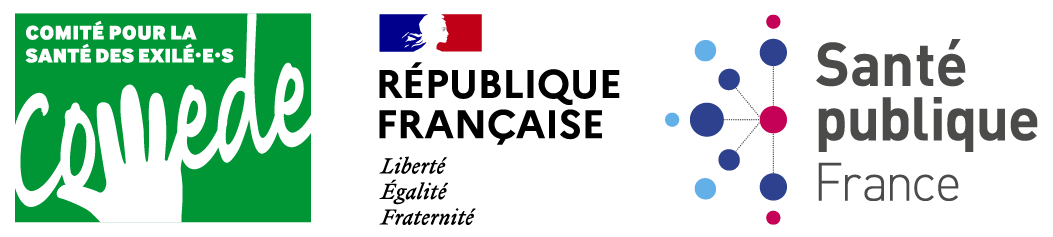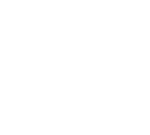12.3. Dispositif pour les soins urgents et vitaux
Accès aux soins, accès aux droits
Article mis à jour le 28/10/2025
Créé en 2003 concomitamment à l’instauration d’un délai d’ancienneté de présence en France de 3 mois pour accéder à l’Aide médicale État (AME), le Dispositif pour les soins urgents et vitaux (DSUV) a pour objectif d’instaurer un financement de l’obligation déontologique des établissements de santé de délivrer les soins indispensables aux personnes dépourvues de tout droit potentiel à une protection maladie, notamment celles inéligibles à l’AME. Il vise à compenser l’exclusion d’une partie des étrangers nouvellement arrivés en France de l’AME. Ce dispositif ne constitue pas un système de protection maladie personnel, mais un mode de paiement des soins « urgents » (voir définition infra) fournis par l’hôpital public ou privé. Il n’ouvre donc pas de droits personnels à l’AME. Son champ d’application exclut les titulaires d’un visa en cours de validité.
Textes de référence
Article L254-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) : « Les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître et qui sont dispensés par les établissements de santé aux étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à L160-1 du Code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat en application de L251-1 ainsi qu’aux demandeurs d’asile majeurs qui ne relèvent pas du régime général d’assurance maladie sont pris en charge dans les conditions prévues à L251-2. Une dotation forfaitaire est versée à ce titre par l’Etat à la Caisse nationale de l’assurance maladie ». La liste des textes réglementaires, circulaires et notes pratiques concernant le DSUV sera développée dans un article à venir.
Attention : les étrangers éligibles à l’AME, ou en cours d’instruction d’une demande d’AME et ayant besoin d’un accès rapide aux soins ne relèvent pas du Dispositif des soins urgents et vitaux, mais relèvent de l’AME de droit commun via la procédure dite « d’instruction prioritaire » (voir 13.5. Aide médicale Etat – mise en ligne à venir).
Nature de la prestation et lien avec l’Aide médicale Etat de droit commun
Bien qu’inséré au titre V. du CASF, le Dispositif L254‑1 ou DSUV n’est pas une prestation d’Aide médicale État (AME). Pour identifier la place du DSUV dans l’architecture globale de la protection maladie en France, il est recommandé de se référer au Schéma simplifié du système français de protection maladie disponible au 13.1 Organisation générale du système de protection maladie. Le DSUV y est identifié par le repère ④.
À la différence de l’AME de droit commun, le DSUV n’ouvre pas de droits personnels à une protection maladie pour l’année à venir, mais vise à soutenir les hôpitaux face au risque de créance irrécouvrable a posteriori des soins fournis. Le bénéfice du DSUV est cependant un droit patrimonial pour lva personne qui en remplit les conditions, et est justiciable devant le juge de l’aide sociale (Conseil d’Etat, 30/12/2021, n°448688), lequel s’autorise à requalifier une demande d’Aide médicale État de droit commun qu’il rejette, en une demande de bénéfice du DSUV qu’il octroie (Commission centrale d’aide sociale, 27 avril 2006 ; n°051413).
Attention : les dénominations « Soins urgents » et « Aide médicale d’urgence (AMU) » sont à éviter car elles entretiennent la confusion d’une part avec le recours au service hospitalier des urgences médico-chirurgicales lui‑même, et d’autre part avec la procédure de traitement accélérée d’une demande d’Aide médicale Etat.
Le contentieux du DSUV relève depuis le 01/01/2019 du Tribunal administratif du département, suite à la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, puis de la Cour administrative d’appel (et non plus de la Commission départementale d’aide sociale, ni de la Commission centrale d’aide sociale, ces juridictions ayant été supprimées). Le Conseil d’Etat reste la juridiction de cassation.
Personnes concernées
Selon la loi, deux catégories de personnes sont éligibles :
- les personnes (non-demandeuses d’asile), réunissant les quatre conditions suivantes:
– être de nationalité étrangère (y compris les citoyens UE/EEE/Suisse) ;
– « résider » en France ;
– être en séjour irrégulier au sens de la réglementation sur la police des étrangers (sur la distinction entre règles relatives à l’immigration et règles relatives aux droits sociaux, voir 10.2. Bilan social et juridique ; sur les titulaires de visa, voir les développements ci-dessous) ;
– ne pas remplir les conditions pour bénéficier de l’AME de droit commun (voir précisions infra) ;
- Les demandeurs d’asile enregistrés au Guda (voir 6.3. En préfecture, procédure normale) présents en France depuis moins de 3 mois (ou qui ne parviennent pas à prouver leur ancienneté de présence de 3 mois). Il s’agit donc d’étrangers qui remplissent la condition de séjour légal au sens de l’assurance maladie (titulaires du titre de séjour provisoire dénommé « Attestation de demande d’asile »), mais qui sont exclus de l’Assurance maladie faute de justifier de 3 mois d’ancienneté de présence en France.
En pratique, il s’agit :
– des étrangers présents en France depuis moins de 3 mois, sans visa ou dont le visa est venu à expiration au moment de la demande (voir les précisions infra) ;
– des étrangers résidant irrégulièrement en France depuis plus de 3 mois mais sans pouvoir apporter la preuve de leur présence au cours des 3 derniers mois (attention, le contrôle de la présence en France au cours des 3 mois précédant une demande d’AME ne concerne pas les cas de renouvellement ; voir 11.1. Protection sociale selon le statut / Repères et panorama) ;
– des étrangers présents en France depuis plus de 3 mois, mais inéligibles à l’AME faute de remplir depuis plus de 3 mois la condition de séjour irrégulier (généralement dans les 3 mois suivant la péremption de leur visa ou document de séjour) ;
– des étrangers résidant en France depuis plus de 3 mois en situation irrégulière, recevant une facture pour des soins « urgents et vitaux » dispensés il y a moins d’un an, et pour lesquels il est trop tard pour demander l’AME de droit commun (faute d’avoir demandé l’AME dans les 90 jours suivant les soins) ;
– des étrangers résidant en France depuis plus de 3 mois en situation irrégulière, mais exclus de toute protection maladie du fait de ressources supérieures au plafond de l’AME (voir infra Conditions de ressources) ;
– des demandeurs d’asile titulaires d’une Attestation de demande d’asile (toute procédure d’asile) qui ne peuvent pas justifier d’une ancienneté de présence en France de 3 mois.
Les mineurs ne relèvent pas du DSUV, mais n’en sont pas exclus « de droit ». Si la circulaire ministérielle du 7 janvier 2008, indique que « les soins dont bénéficient [les] enfants mineurs ne doivent plus être imputés sur le dispositif des soins urgents », ce n’est pas parce que la loi les prive du droit au DSUV, mais parce que les mineurs sont supposés pouvoir accéder dans tous les cas à l’Aide médicale État de droit commun pour financer leurs soins, le recours au DSUV devenant sans objet.
Les personnes étrangères majeures, sous visa en cours de validité, sont exclues. Il en est de même pour les personnes d’une nationalité dispensée de visa court-séjour pour entrer en France. En effet, le dispositif vise les étrangers en séjour irrégulier au sens de la police des étrangers (pour les titulaires de visa court-séjour et les personnes dispensées de visa, voir les décisions du Conseil d’Etat du 30 décembre 2021, n°448689 et suivantes). Les titulaires de visa sont donc exclus du dispositif DSUV (et de l’AME de droit commun) pendant la période de validité de leur visa. Ils sont également exclus de l’assurance maladie, notamment du fait que les visas de court séjour ne figurent pas dans la liste des documents exigés, sauf très rares exceptions. Les précisions sur le DSUV et les visas seront développées dans la seconde partie de cet article (à venir).
Attention : aucune condition de ressources n’est mentionnée par la loi. Le DSUV peut être activé au profit de personnes exclues de l’AME de droit commun du fait de ressources supérieures au plafond, si les conditions médicales sont remplies (Circulaire ministérielle DSS/2A n° 2011/351 du 8 septembre 2011 et Note d’information interministérielle n° DSS/2A/DB/2022/125 du 26 avril 2022).
Définition des soins « urgents et vitaux »
Une définition plus large que l’urgence « vitale ». Le DSUV ne se limite pas à la couverture des situations d’« urgences vitales », mais inclut tous les soins dont le défaut pourrait conduire à « une altération grave et durable de l’état de santé » (voir supra L254–1 CASF). La circulaire ministérielle du 16 mars 2005 y inclut de manière non limitative les situations suivantes : les soins destinés à éviter la propagation d’une pathologie à l’entourage ou à la collectivité (pathologies infectieuses transmissibles telles que la tuberculose ou le VIH, par exemple) ; la grossesse (examens de prévention durant et après la grossesse, soins à la femme enceinte et au nouveau-né) ; IVG et interruption médicale de grossesse.
Soins hospitaliers et consultations externes. Aux termes de la circulaire ministérielle du 16 mars 2005, hospitalisations, frais de transport et consultations externes sont pris en charge. Attention : seuls les médicaments prescrits à l’occasion de la délivrance des soins « urgents » seront pris en charge par le DSUV (avec possibilité de maintien si la prescription initiale émane du médecin hospitalier et si ce dernier atteste de la nécessité de la poursuite du traitement après les soins hospitaliers). Les transports sanitaires peuvent théoriquement être pris en charge, même si l’exigence par les transporteurs d’un paiement préalable rend le système inapproprié en pratique.
Si possible, l’ouverture préalable d’une AME ou le dépôt d’une demande d’AME dans les 90 jours suivant les soins, est toujours préférable à l’utilisation rétrospective du DSUV, lequel ne permet pas la continuité des soins au-delà de l’hospitalisation en cause (demande d’AME si besoin en procédure d’instruction prioritaire ; voir 13.5).
Nature le la prise en charge :
– lieu de soins : aux termes de la loi, sont pris en charge les soins dispensés en établissements de santé tant publics que privés. En revanche, les soins en ville au sens strict sont exclus (pour les soins hospitaliers externes, voir point précédent) ;
– niveau de couverture : il s’agit d’une couverture identique à celle de l’AME de droit commun (renvoi à L251‑2 du CASF), c’est à dire à ce jour l’équivalent d’un « 100 % Sécurité sociale » ;
– gratuité : l’accès à ce Dispositif est gratuit.
Procédure
Délai d’action. La demande de DSUV doit être faite dans le délai d’un an maximum après les soins.
Les acteurs. Les Caisses primaires d’assurance maladie (Cpam) et les caisses générales de Sécurité sociale (CGSS) sont chargées, pour le compte de l’État, d’instruire les demandes et de servir la prestation (en pratique deux caisses portent un service – dénommé Centre national des soins urgents – de traitement centralisé de l’ensemble des demandes en France). La procédure relève du processus de facturation par les services compétents des hôpitaux. En pratique, et dans la mesure où il ne s’agit pas d’une protection maladie, il n’appartient pas à l’étranger lui-même de mettre en route la demande de prise en charge financière au titre de L254‑1 du CASF. C’est donc l’hôpital qui doit requérir la mise en œuvre du Dispositif, en saisissant la caisse du lieu d’implantation de l’établissement (et non du département de résidence du patient, ni directement de l’un des Centres nationaux des soins urgents) d’une demande de prise en charge au titre du Dispositif L254‑1 du CASF.
Cette procédure requiert donc une coopération étroite entre différents services de l’hôpital :
– d’une part, le service social hospitalier, lequel est habituellement en charge du bilan des droits du patient, pourra conclure à la nécessité de demander une prise en charge au titre des « soins urgents » si aucun autre financement n’est possible ;
– d’autre part, le médecin qui a fourni les soins doit délivrer un certificat médical non‑descriptif attestant que le patient a nécessité « des soins urgents dont l’absence aurait mis en jeu le pronostic vital ou aurait pu conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne » ;
– enfin, les services des frais de séjour, des traitements externes et de la pharmacie, une fois munis de l’information sur le type de prise en charge, devront renoncer à envoyer la facture au patient et saisir la Cpam/CGSS.
L’exigence d’un refus écrit d’Aide médicale État pour présenter une demande de prise en charge au titre du DSUV est imposée par plusieurs circulaires ministérielles. Cette exigence repose sur le principe de subsidiarité qui impose de faire valoir les droits individuels à la protection sociale avant de mobiliser un dispositif financier à vocation limitée (sur la hiérarchisation des dispositifs, voir 13.2.). Pourtant cette exigence pose problème : elle impose de faire une demande d’AME pour des personnes qui n’y sont pas éligibles (par définition), impose un double travail aux caisses concernées, et conduit à des pertes de chance pour l’hôpital et le patient (refus d’AME envoyé au patient ; patient perdu de vue ; facturation DSUV impossible faute de refus AME ; forclusion de la prescription ; facturation et poursuites contre le patient ; risque de créance irrécouvrable). Les hôpitaux sont ainsi exposés à des risques accrus d’abandon involontaire de la procédure, tant que ne sera pas mise en place une procédure unifiée permettant à la Caisse d’évaluer simultanément si la personne relève de l’AME ou du DSUV. A noter, qu’en l’absence de réponse explicite de la Caisse à la demande d’AME, l’établissement de santé est invité à facturer au titre du DSUV sur la base du refus implicite de la caisse réputé acquis au bout de deux mois sans réponse (Instruction ministérielle n° DGS/SP1/DGOS/SDR4/DSS/SD2/DGCS/2018/143 du 8 juin 2018 relative à la mise en place du parcours de santé des migrants primo-arrivants). Enfin concernant les titulaires de l’Attestation de demande d’asile, la demande de DSUV est dispensée de demande préalable d’AME (Note ministérielle d’information n°DSS/2A/2020/43 du 27 février 2020).